1940 - Témoignage d'un soldat du
51e régiment d'infanterie à Stonne
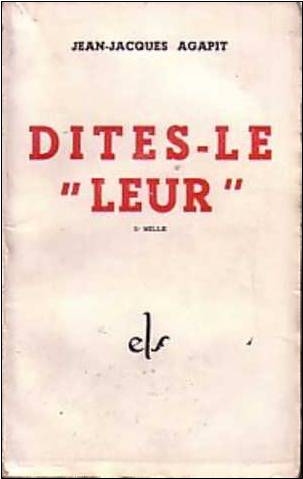 Ce texte, extrait d’un ouvrage publié par Jean-Jacques Agapit en 1941 intitulé « Dites le leur », témoigne de la dureté de la bataille de Stonne, opposant les Français aux Allemands dans la conquète d'une position de première importance. Son auteur, appartenant à la 7ème compagnie du 51ème régiment d'infanterie français, est blessé au combat avant d'être capturé et pris en charge par la Wehrmacht.
Ce texte, extrait d’un ouvrage publié par Jean-Jacques Agapit en 1941 intitulé « Dites le leur », témoigne de la dureté de la bataille de Stonne, opposant les Français aux Allemands dans la conquète d'une position de première importance. Son auteur, appartenant à la 7ème compagnie du 51ème régiment d'infanterie français, est blessé au combat avant d'être capturé et pris en charge par la Wehrmacht.
"Ce dépôt-là est sous un pont. Avec précaution, les Allemands me couchent sur une paillasse humide, et restent près de moi sans un mot. Je ne les distingue plus dans l'abri sombre. Je ne vois que des formes noires qui se penchent sur moi. J'ai laissé tomber mes bras de chaque côté de la paillasse, et mes deux mains sont dans l'eau, une eau qui coule en cascadant.
Le pont franchit un ruisseau. Et dans ce ruisseau-là les Allemands ont mis des planches et, sur les planches, d'autres planches encore, jusqu'à ce que l'eau soit en dessous de cet échafaudage. Et sur les planches il y a des paillasses. Mais, peu à peu, l'échafaudage s'est disloqué, les paillasses ont glissé et maintenant il y a entre elles des ruelles d'eau clapotante. Le matelas est comme une éponge et, quand je tourne la tête, j'entends l'eau qui traverse la toile en sifflant doucement, là, sous mon oreille.
Peu à peu, mes yeux s'habituent à cette demi-obscurité. Il y a là une dizaine de blessés. Ils me regardent un moment, à peine, sans rien dire. Ils sont tout occupés de leurs blessures. Que peut leur importer l'arrivée d'un nouveau blessé ? Je ne vois que les tâches claires des pansements et les yeux qui brillent dans l'ombre.
A intervalles réguliers, je sens qu'ils bougent. Je comprends qu'ils touchent leurs blessures, par-dessus le pansement. Ils tâtent, pour voir. Ils sentent sous leurs doigts le suintement du sang qui traverse les bandes sales. Es sentent sous leurs doigts la tache qui va grandissant, la tache qui doit être noire. Alors ils laissent leur main rougie un moment immobile, sur la paillasse mouillée, puis ils recommencent... pour voir.
Près de moi, il en est un qui ne fait pas ce geste machinal. Celui-là, il a les deux bras enfoncés dans des moufles blanches. Il est assis, le dos appuyé aux pierres suintantes. Dans la faible clarté qui pénètre encore dans le refuge, je ne vois que sa face pâle et le bout des moufles. Celui-là, qui ne peut pas tâter le sang, il regarde. Il regarde, affolé, cette tache noire au bout, puis rouge, puis rosé, cette tache qui monte, qui atteint déjà le coude et qui va gagner l'épaule. Un soldat allemand porte aux lèvres de ce blessé un sandwich de pain noir. Il attend que l'autre ait avalé, bouchée par bouchée. Et, tout en mâchonnant, le blessé regarde la tache qui monte.
Bien que cet asile ouvre sur la campagne enflammée l'ouverture de l'arche, une odeur pestilentielle stagne au-dessus des paillasses, stagne ou passe. Chaque fois que la toile de tente qui ferme le pont en amont se soulève, l'odeur devient plus forte, l'odeur qui donne envie de vomir.
L'incendie s'est rapproché du pont. Il y a sur le mur des fantômes noirs qui dansent dans la lueur rouge. J'étouffe. J'ai soif. Je demande à boire. Un soldat allemand me montre son bidon vide. Ils nous ont tout donné, tout leur café, tout leur vin, du vin qui avait été le nôtre.
- Water?
II fait non de la tête. Je lui montre le ruisseau. Alors il va vers le fond de l'abri, soulève la toile de tente, et, dans le rougeoiement d'une ferme qui brûle, je vois des cadavres d'hommes et de chevaux raidis, des cadavres de chevaux qui éclatent, des cadavres dans l'eau. Pendant que l'Allemand revient, je pense que ce ruisseau-là, c'est celui dans lequel j'ai bu, tantôt.
Deux brancardiers amènent un blessé et le déposent près de moi, de l'autre côté de la ruelle d'eau. Un pansement rouge déjà entoure son front, un pansement qui ne peut plus retenir le sang. Trois lignes noires, sinueuses, glissent sur la face, et, arrivées au cou, elles n'en font plus qu'une seule, grosse, qui s'arrête un moment au col de la capote en lambeaux, puis va se perdre quelque part, entre la poitrine et le ventre, là où le ceinturon serre la chemise sur la peau. Je n'ai rien à dire à ce nouveau compagnon. Lui, à moi, non plus. Il reste prostré sur son grabat mouillé, les yeux fixés sur la voûte, et le mouvement qu'il fait pour tâter le pansement poisseux me dit seul que l'homme n'est pas mort.
Dehors, il n'y a pas de nuit. Tout est rouge de l'incendie qui longe le pont. Rouge le ciel, rouge la terre, rouges les soldats qui passent. Quand ils entrent dans l'abri, ils font des ombres noires, des ombres qui tombent parfois dans l'eau qui sourd entre les paillasses, dans l'eau qui a des reflets rouges. Des gémissements s'élèvent et meurent sous la voûte.
Le sang s'est arrêté sur les moufles blanches, il s'est arrêté au-dessus du coude. Il y a la tache noire, puis brune, puis rosé sur le bord. Mais l'incendie met des lueurs fauves sur le pansement, et le blessé regarde. Le dernier arrivé porte toujours sa main de la paillasse humide à son front mouillé, les trois filets de sang se sont coagulés au-dessus du col souillé de terre.
Un infirmier me couvre sans rien dire d'une courtepointe mouillée. Je m'endors entre deux éponges, pendant que l'air est ébranlé par le tir d'une batterie proche, que l'incendie achève de s'éteindre, et qu'une douleur sourde parcourt lentement ma jambe.
Le lendemain, dès l'aube, je suis porté jusqu'à une voiture " tout-terrain". Avec beaucoup de ménagements, les infirmiers m'installent sur la banquette. Ils voudraient m'allonger, mais la voiture n'est pas assez large. Il me faut donc rester assis, avec le pied pendant, emmailloté dans son pansement sanglant. Avant le départ, le chauffeur écoute les ordres et m'assure d'un geste que je ne serai pas bousculé. Trois soldats montent de pan et d'autre sur les marchepieds, un sous-officier s'assied près du pilote et nous partons. Il fait bon. L'air est frais. Je respire fort ce vent qui m'étouffe un peu, ce vent qui ne sent plus l'incendie, qui ne sent plus la mort. La voiture prend de la vitesse.
Je dégrafe ma chemise, pour recevoir la caresse du vent sur la poitrine. J'enlève mon casque et je sens mes cheveux emmêlés traversés par l'air froid. Mais le chef du détachement se retourne et me fait comprendre qu'il faut garder le casque. J'insiste pour ne pas le faire. Il me montre alors le ciel bleu et, de la main, il dessine une courbe qui s'arrête sur son crâne. Je remets mon casque.
La route est coupée partout. Partout il y a de profonds entonnoirs. Notre voiture les contourne et chaque fois que nous avons frôlé le trou, sans jamais y tomber, le pilote me regarde à travers ses lunettes étroites. Ses yeux sourient au-dessus de ses lèvres.
- Bon... bon...
II est fier de sa machine et de son habileté.
Partout, sur la route, dans les champs bouleversés, dans les trous d'obus, je vois des cadavres kaki. Je vois La Berlière, à droite, dans un petit val, des murs sur des murs. Nous traversons Stonne en ruines. Nous longeons des carcasses de camions, tordues par les flammes, des sidecars qui piquent leur panier dans la terre, des voitures hippomobiles couchées dans le fossé, auprès des chevaux morts. Trois spahis sont agenouillés, la tête baissée jusqu'au sol, l'un derrière l'autre, comme s'ils avaient été frappés par la mort en faisant leur prière. Des masses de ferraille dorment en plein champ. Restes de tanks. Monstres arrêtés dans leur course dévastatrice.
Derrière nous, à l'horizon, deux colonnes de fumée se dressent vers le ciel, puis se courbent sous le vent. Vouziers, peut-être ?
Parfois, allongé dans un fossé, le dos appuyé au talus, un cadavre nous regarde passer. Je vois la peau noire du visage et la bouche tordue qui semble crier pour moi quelque chose. Sans oser me retourner, je crois sentir fixés sur ma nuque les yeux du mort qui suivent ma course vers la vie.
De place en place, une croix de bois supporte un casque allemand.
Brutalement, comme on sort d'un cauchemar, nous laissons derrière nous le funèbre paysage, Les arbres ont placé un rideau de verdure entre la mort et nous comme le machiniste fait glisser un rideau de velours vert entre les spectateurs et le décor d'enfer. De ce côté-ci, c'est encore la guerre, soit, mais une guerre qui ressemble à celle des grandes manœuvres. Il y a de la gaieté sous les arbres, autour des tentes bariolées, auprès des abreuvoirs camouflés de branchages. Il y a de la gaieté autour de la roulante. Il y a de la gaieté partout.
Mes gardiens se dérident, l'un d'eux m'offre une cigarette, l'autre me sourit. Ils se sentent chez eux, tout d'un coup, parmi ces soldats qui se lavent, torse nu en chantant. Ici, on dirait qu'il n'y a jamais eu la guerre. Les trous d'obus sont devenus des fosses de D.C. A. Les arbres cassés ont servi au camouflage, et les maisons brillent au soleil. Une " saucisse" tourne autour de son câble, là-haut, dans le ciel, comme un jouet d'enfant.
Il fait bon vivre.
Et je sens que s'efface peu à peu l'image de mes camarades morts entre Stonne et La Berlière. Nous croisons des véhicules militaires et mes compagnons échangent de bruyants saluts avec les occupants des voitures descendantes, comme des touristes font le dimanche. Et puis, tout sent bon dimanche. Le petit chemin ensoleillé que nous suivons, entre champs et buissons, les chevaux qui piaffent autour des abreuvoirs, le ciel, la campagne.
Tout d'un coup, la voiture s'arrête. Cette secousse imprévue projette mon pied contre le blindage et le sang coule goutte à goutte. Malgré les essais du pilote, le moteur ne tourne plus. Mes gardiens vont s'asseoir au bord du talus et devisent joyeusement avec leur chef, le chauffeur s'est glissé sous la voiture. Je suis tout seul. Tout seul.
Dans les poches des accoudoirs, il y a des grenades dont les manches dépassent. Je suis tout seul. Je n'aurais qu'à allonger la main. Mon regard va des allemands joyeux aux manches jaunes qui dépassent de la moleskine noire. Non...non ! Je ne peux pas ! Plus maintenant. J'enfonce mes mains dans les poches de ma capote sanglante. Le moteur tourne, nous repartons.
C'est en side-car que je continue le voyage. Enfoncé dans le panier bas, la jambe blessée attachée contre le blindage, je parcours lentement ce décor de grandes manœuvres. Le pilote de la machine me regarde tous les cent mètres. Si le panier se secoue trop, il réduit encore notre faible vitesse. A cette allure de promenade, nous arrivons à Raucourt où je subis le premier interrogatoire d'identité. L'officier allemand me fait conduire à l'hôpital le plus proche et me regarde partir en répétant :
- Bons vœux pour guérison.
L'hôpital, enfin ! Dans une salle d'attente, garage blanchi à la chaux, paillasse sur le sol, deux infirmiers me déposent Un groupe d'Allemands blessés que j'avais aperçu en entrant se rapproche et me regarde. L'un d'eux se détache, vient auprès du sous-officier qui semble diriger ce dépôt et engage avec lui une courte conversation, d'où je ne retiens que le mot : "Kamarad", souvent répété. Puis le blessé vient vers moi en souriant :
- Voulez-vous je dire un mot ?
Nous n'en disons pas beaucoup plus, car je suis transporté dans une ambulance hippomobile et je traverse à nouveau Raucourt. Nouvel hôpital. Nouvelle salle d'attente. Celle-ci, c'est un hangar d'usine. Appuyés aux murs, des tas de chiffons, de déchets. On sent la laine mouillée, comme dans les usines de tissage, chez nous, à Elbeuf ou à Louviers.
Devant une planche large que supportent des tréteaux, un soldat allemand peint des lettres blanches sur des croix de bois noires, des lettres qui forment des noms français. Deux infirmiers déposent un blessé sur un brancard, à côté de moi. De la couverture, sortent deux gouttières entourées de bandes blanches. L'homme regarde, à droite, à gauche, comme un qui se réveille. Longtemps, son regard s'arrête sur les croix noires. Puis il me voit, m'examine, hésite et, désignant d'un mouvement de menton quelque chose vers le bas, vers la couverture, il prononce :
- Les deux jambes.
A l'odeur de laine mouillée se mêle une odeur d'éther. Le blessé s'est endormi. Le peintre en lettres claque des talons et s'immobilise devant sa table. Le docteur vient d'entrer et s'approche de mon brancard. II regarde le blessé assoupi, et se tournant vers moi :
- Monsieur... le pied ? Sedan...
Ambulance automobile. Je suis seul. II fait sombre, car les petites vitres sont dépolies, comme dans toutes les ambulances militaires. Est-ce pour éviter la curiosité des foules ou pour permettre au blessé de mieux penser à sa plaie, dans cette demi-obscurité ?
Je souffre peu. Mais à partir de quelle douleur souffre-t-on beaucoup ? La jambe est enflée, et, sous les doigts qui palpent la peau tendue, je sens, au pli de l'aine, une grosseur inquiétante.
Un trottoir que nous franchissons. Des voix françaises et allemandes autour de l'ambulance arrêtée. Nous sommes arrivés. Sedan !
Plus d'un an après y avoir vécu trente-six heures, ce nom évoque pour moi le plus triste souvenir de ma captivité. Et j'en ai connu qui sont restés trois jours dans cet antre, où la douleur physique et la douleur morale étaient maîtresses.
Sedan, c'est un gymnase. Une salle immense aux murs sombres, dépendance du collège Turenne. Le gymnase est divisé en deux parties : à droite, un magasin où s'empilent les matelas et la vaisselle nécessaire à cet hôpital auxiliaire; à gauche, une litière de paille courte où les brancardiers allongent les blessés français qui partiront vers l'Allemagne.
Sur le ciment sombre, quatre tas de paille sale. Deux qui se font face, le long des murs, un qui traverse la salle, sous une barre fixe, et tout près de moi, un autre, en hauteur. Celui-ci, c'est la paille de rechange... Et sur la paille courte, étalée en une mince couche grise, de pauvres corps boueux et sanglants attendent quelque chose qui ne vient pas : Le pansement.
Ces hommes-là, ce sont des hommes sans âge, presque des bêtes. Quelques-uns tournent vers moi leur face creusée par la douleur et la fatigue, leur face barbue entourée de cheveux longs qui retiennent des brindilles de paille. Je n'en reconnais aucun, mais ils sont tous méconnaissables. Ceux qui possèdent encore un bout d'uniforme l'ont fait rouler sous leur tête. Il y en a qui sont presque nus."
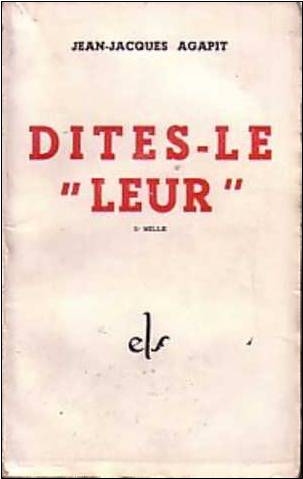 Ce texte, extrait d’un ouvrage publié par Jean-Jacques Agapit en 1941 intitulé « Dites le leur », témoigne de la dureté de la bataille de Stonne, opposant les Français aux Allemands dans la conquète d'une position de première importance. Son auteur, appartenant à la 7ème compagnie du 51ème régiment d'infanterie français, est blessé au combat avant d'être capturé et pris en charge par la Wehrmacht.
Ce texte, extrait d’un ouvrage publié par Jean-Jacques Agapit en 1941 intitulé « Dites le leur », témoigne de la dureté de la bataille de Stonne, opposant les Français aux Allemands dans la conquète d'une position de première importance. Son auteur, appartenant à la 7ème compagnie du 51ème régiment d'infanterie français, est blessé au combat avant d'être capturé et pris en charge par la Wehrmacht.